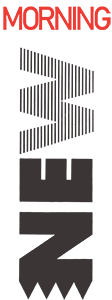Jeudi 03/11/2016

Batterie
Saxophone
Piano
Contrebasse
Tony Allen
Place au père-fondateur de l'afrobeat, qui, à 75 ans, n'a rien perdu de sa superbe. Avec l'aisance implacable d'un sage, le batteur nigérian rend hommage à l'une de ses plus fortes sources d'inspiration, son homologue américain Art Blakey, inventeur du « hard bop ».
Entre expérimentations sonores, collaborations inattendues et remix pointus, Tony Allen, l'ancien batteur de Fela, n'en finit pas de se réinventer. Celui qui co-inventa l'afrobeat à coups de charley, « le sorcier de Lagos », compagnon d'armes de Fela pendant plus de dix ans, est décrit par Brian Eno comme « le plus grand batteur qui ait jamais vécu »...
Tony Allen âgé de 75 ans est un musicien qui n'en finit pas de brûler les planches. « Un dieu du beat » très humain qui doute, qui cherche toujours, et qui d'album en album n'en finit pas de prendre les chemins de traverse, de foncer là où, on ne l'attend pas.
Ce n'est que justice, le batteur inventeur de l'afrobeat rendant hommage au batteur inventeur du hard bop, et de tellement plus. Car depuis quelques années que Tony Allen connaît une seconde jeunesse à Paris et ailleurs, ne reculant devant aucune expérience, enregistrant avec les grandes pointures de la techno et de l'électro, tels Sébastien Tellier ou Moritz von Oswald, formant le « supergroupe » Rocket Juice and The Moon avec Damon Albarn (le chanteur de Blur et de Gorillaz) et Flea (le bassiste des Red Hot Chili Peppers), recevant de la bouche même de Brian Eno le plus hardi des compliments (il serait peut-être le plus grand batteur de tous les temps), on a eu tendance à oublier que son style si particulier (l'articulation/désarticulation des éléments de la batterie, l'insistance sur la Charley et la cymbale ride permettant de lâcher les coups sur les autres tambours) lui vient autant de ses sources africaines et nigérianes, que des boppers rythmiciens que furent Kenny Clarke, Max Roach et, en particulier, Art Blakey. Lesquels auraient tous pu contresigner sa déclaration : « Je m'engage dans la batterie comme dans un orchestre, j'essaye de rendre mon jeu orchestral. ».
On sait que Tony Allen fut, de 1968 à 1979, le temps de 36 albums, une bagatelle, non seulement le batteur mais le directeur artistique de Fela Anikulapo Kuti qui décréta que, « sans Tony Allen, il n'y aurait pas d'afrobeat ». On trouvera le récit de cette histoire décidément palpitante dans l'autobiographie (coécrite avec le bassiste et musicologue américain Michael Veal, qui se produisit en 2010 à Sons d'hiver avec son propre ensemble, Aqua Ife) : Tony Allen: an Autobiography of the Master Drummer of Afrobeat. On sait moins, en revanche, que les deux amis se rendirent ensemble aux États-Unis, au milieu des années 60, alors que le Mouvement des droits civiques et celui du Black Power battaient leur plein. C'est là qu'ils aiguisèrent leur conscience politique et reçurent la confirmation de la marche à suivre, développée dans leurs formations successives – Koola Lobitos, Nigeria 70, Afrika 70 : ajouter aux rythmes yoruba et au style High-Life de nouveaux ingrédients, puisés du côté de la musique dite modale et de la musique dite "free" des formations de Miles Davis et de John Coltrane, du côté de la soul de James Brown et du rock de Jimi Hendrix, voire de la salsa....
Fela confia ainsi, après son séjour américain : « Le jazz m'a servi de porte d'entrée dans l'univers des musiques africaines. Plus tard, quand je suis allé en Amérique, j'ai été exposé à l'histoire de l'Afrique, dont je n'avais jamais entendu parler ici. C'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à comprendre que je n'avais jamais joué de musique africaine. J'avais utilisé le jazz pour jouer de la musique africaine, alors que j'aurais dû utiliser la musique africaine pour jouer du jazz. Ainsi c'est l'Amérique qui m'a ramené à moi-même. » Il n'est pas incohérent de faire des chant et choeurs responsoriaux de l'afrobeat, de ses tournures et tournoiements répétitifs et de ses riffs de cuivres en rafale, de ses solos exaltés et de ses grooves étirés, de ses rythmes croisés, une authentique musique de l'Atlantique noire.
S'il y eut de nombreuses suites (par exemple en 1977, lorsque Lester Bowie, le trompettiste de l'Art Ensemble of Chicago, fut accueilli dans la commune libre de Kalakuta, à Lagos, par Fela et par Tony Allen, et qu'il s'y produisit avec Archie Shepp et des membres de l'Arkestra de Sun Ra pour protester contre les détournements économiques, politiques et symboliques du Second World African Festival of Arts and Culture), il faut savoir qu'il y eut quelques antécédents, du côté d'Art Blakey précisément. On raconte que Blakey fit un voyage "initiatique" au Nigéria, dès la fin des années 40, dont plusieurs disques de prolifération rythmique réalisés ensuite, avec ou sans le concours des Jazz Messengers, portent la trace. Notamment le bien-nommé « The African Beat », enregistré en 1962 avec un Afro-Drum Ensemble créé pour la circonstance et auquel se joignirent James Ola Folami et Solomon Ilori, venus du Nigéria. Ilori dit alors de Blakey qu'il était « capable de faire réussir cette fusion, car cette fusion existe déjà en lui ». Elle existe aujourd'hui chez Tony Allen, qui prolonge ce dont Stuart Hall parlait comme de « processus de créolisation et de diasporisation ».

Place au père-fondateur de l'afrobeat, qui, à 75 ans, n'a rien perdu de sa superbe. Avec l'aisance implacable d'un sage, le batteur nigérian rend hommage à l'une de ses plus fortes sources d'inspiration, son homologue américain Art Blakey, inventeur du « hard bop ».
Entre expérimentations sonores, collaborations inattendues et remix pointus, Tony Allen, l'ancien batteur de Fela, n'en finit pas de se réinventer. Celui qui co-inventa l'afrobeat à coups de charley, « le sorcier de Lagos », compagnon d'armes de Fela pendant plus de dix ans, est décrit par Brian Eno comme « le plus grand batteur qui ait jamais vécu »...
Tony Allen âgé de 75 ans est un musicien qui n'en finit pas de brûler les planches. « Un dieu du beat » très humain qui doute, qui cherche toujours, et qui d'album en album n'en finit pas de prendre les chemins de traverse, de foncer là où, on ne l'attend pas.
Ce n'est que justice, le batteur inventeur de l'afrobeat rendant hommage au batteur inventeur du hard bop, et de tellement plus. Car depuis quelques années que Tony Allen connaît une seconde jeunesse à Paris et ailleurs, ne reculant devant aucune expérience, enregistrant avec les grandes pointures de la techno et de l'électro, tels Sébastien Tellier ou Moritz von Oswald, formant le « supergroupe » Rocket Juice and The Moon avec Damon Albarn (le chanteur de Blur et de Gorillaz) et Flea (le bassiste des Red Hot Chili Peppers), recevant de la bouche même de Brian Eno le plus hardi des compliments (il serait peut-être le plus grand batteur de tous les temps), on a eu tendance à oublier que son style si particulier (l'articulation/désarticulation des éléments de la batterie, l'insistance sur la Charley et la cymbale ride permettant de lâcher les coups sur les autres tambours) lui vient autant de ses sources africaines et nigérianes, que des boppers rythmiciens que furent Kenny Clarke, Max Roach et, en particulier, Art Blakey. Lesquels auraient tous pu contresigner sa déclaration : « Je m'engage dans la batterie comme dans un orchestre, j'essaye de rendre mon jeu orchestral. ».
On sait que Tony Allen fut, de 1968 à 1979, le temps de 36 albums, une bagatelle, non seulement le batteur mais le directeur artistique de Fela Anikulapo Kuti qui décréta que, « sans Tony Allen, il n'y aurait pas d'afrobeat ». On trouvera le récit de cette histoire décidément palpitante dans l'autobiographie (coécrite avec le bassiste et musicologue américain Michael Veal, qui se produisit en 2010 à Sons d'hiver avec son propre ensemble, Aqua Ife) : Tony Allen: an Autobiography of the Master Drummer of Afrobeat. On sait moins, en revanche, que les deux amis se rendirent ensemble aux États-Unis, au milieu des années 60, alors que le Mouvement des droits civiques et celui du Black Power battaient leur plein. C'est là qu'ils aiguisèrent leur conscience politique et reçurent la confirmation de la marche à suivre, développée dans leurs formations successives – Koola Lobitos, Nigeria 70, Afrika 70 : ajouter aux rythmes yoruba et au style High-Life de nouveaux ingrédients, puisés du côté de la musique dite modale et de la musique dite "free" des formations de Miles Davis et de John Coltrane, du côté de la soul de James Brown et du rock de Jimi Hendrix, voire de la salsa....
Fela confia ainsi, après son séjour américain : « Le jazz m'a servi de porte d'entrée dans l'univers des musiques africaines. Plus tard, quand je suis allé en Amérique, j'ai été exposé à l'histoire de l'Afrique, dont je n'avais jamais entendu parler ici. C'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à comprendre que je n'avais jamais joué de musique africaine. J'avais utilisé le jazz pour jouer de la musique africaine, alors que j'aurais dû utiliser la musique africaine pour jouer du jazz. Ainsi c'est l'Amérique qui m'a ramené à moi-même. » Il n'est pas incohérent de faire des chant et choeurs responsoriaux de l'afrobeat, de ses tournures et tournoiements répétitifs et de ses riffs de cuivres en rafale, de ses solos exaltés et de ses grooves étirés, de ses rythmes croisés, une authentique musique de l'Atlantique noire.
S'il y eut de nombreuses suites (par exemple en 1977, lorsque Lester Bowie, le trompettiste de l'Art Ensemble of Chicago, fut accueilli dans la commune libre de Kalakuta, à Lagos, par Fela et par Tony Allen, et qu'il s'y produisit avec Archie Shepp et des membres de l'Arkestra de Sun Ra pour protester contre les détournements économiques, politiques et symboliques du Second World African Festival of Arts and Culture), il faut savoir qu'il y eut quelques antécédents, du côté d'Art Blakey précisément. On raconte que Blakey fit un voyage "initiatique" au Nigéria, dès la fin des années 40, dont plusieurs disques de prolifération rythmique réalisés ensuite, avec ou sans le concours des Jazz Messengers, portent la trace. Notamment le bien-nommé « The African Beat », enregistré en 1962 avec un Afro-Drum Ensemble créé pour la circonstance et auquel se joignirent James Ola Folami et Solomon Ilori, venus du Nigéria. Ilori dit alors de Blakey qu'il était « capable de faire réussir cette fusion, car cette fusion existe déjà en lui ». Elle existe aujourd'hui chez Tony Allen, qui prolonge ce dont Stuart Hall parlait comme de « processus de créolisation et de diasporisation ».
Batterie
Saxophone
Piano
Contrebasse